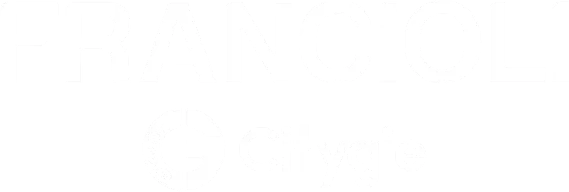La trame brune est un concept relativement récent qui s'inscrit dans la palette des trames vertes, bleues ou noire. Toutes cherchent à construire des ponts garantissant la continuité écologique entre les différentes dimensions spatiales de la ville. Quelles sont les spécificités des trames brunes ? Pourquoi et comment les préserver et les développer sur sa commune ?
Qu’est-ce qu’une trame brune ?
La trame brune est un concept émergent qui s'intéresse aux sols et à leur rôle dans la préservation des autres continuités écologiques terrestre (trame verte), aquatique (trame bleue), ou encore lumineuse (trame noire).
Les trames vertes et bleues (TVB) ont été introduites dès 2009 avec les lois issues du Grenelle de l'environnement. La trame brune est une notion apparue plus tardivement de façon officielle, avec la loi du 22 août 2021 de lutte contre le dérèglement climatique.
Les trames brunes sont des corridors écologiques développés dans le cadre d’opérations de renaturation de l'espace urbain. Leur continuité favorise la conservation de l'intégrité physico-chimique et biologique du sol.
La préservation des trames brunes répond à des défis majeurs de l'urbanisme contemporain. Dès lors qu’un de ces corridors est rompu, les capacités d'absorption de l'eau et d’évapotranspiration du sol sont réduites. Le risque d'inondation et de formation d'îlots de chaleur augmente ainsi irrémédiablement sur les sols artificialisés.
La trame brune soutient les autres corridors écologiques, mais elle constitue aussi un réservoir de biodiversité menacé par l’urbanisation.
La trame brune, plus qu’un support au végétal
La trame brune n'est pas seulement un support à la végétation. Elle abrite une biodiversité très riche en espèces vivant dans l'humus. Ces dernières sont généralement plus nombreuses et plus diverses que celles évoluant à la surface du sol.
Cette cohabitation dense et plurielle conditionne la bonne dégradation des débris végétaux et leur incorporation profonde dans les sols pour le stockage du CO2 absorbé par les plantes. La transformation de ces éléments en nutriments alimente par ailleurs tout le cycle de vie du sol.
Les trames brunes, bien réparties et en quantités suffisantes, jouent aussi un rôle dans le cycle de l'eau en favorisant son infiltration et en assurant une meilleure régulation. Les surfaces de pleine terre permettent ainsi de se prémunir à la fois contre les effets de l'eau en excès, mais aussi contre le manque d'eau. De plus, elles contribuent à retenir une partie des polluants est donc à filtrer les eaux de ruissellement.
La mise en place de la trame brune à différentes échelles
En zone urbaine, plusieurs éléments sont susceptibles d'affecter l'intégrité des sols : les fondations des bâtiments, les réseaux de transport souterrain, les réseaux enfouis d'énergie et de télécommunication… Pour rétablir le lien en profondeur, il faut agir à différentes échelles.
La recherche des trames brunes à l'échelle du territoire
À l'échelle des territoires, les collectivités doivent faire l'inventaire des trames brunes existantes. Cette phase de diagnostic commence par la prise de connaissance des documents d'urbanisme comme le PLU. Les différents espaces végétalisés et aquatiques sont identifiés et permettent de dresser un premier diagnostic écologique.
La planification des trames brunes par quartier
À l'échelle du quartier, il est possible de mettre en place des plans de zones à protéger, de définir des emplacements réservés ou d'imposer des coefficients de pleine terre. Ces actions seront définies en fonction des éléments du diagnostic écologique. Les trames bleues, vertes et brunes sont complémentaires et doivent être déployées avec une vision globale garantissant l'équilibre des milieux renaturés.
Les actions concrètes sur chaque parcelle
Chaque parcelle de terrain pourra être désimperméabilisée ou renaturée. Le bâti n'est pas exclu de la trame brune, mais son emplacement doit être réfléchi pour éviter la fragmentation écologique. Il est par exemple possible de mettre en œuvre des constructions sur pilotis avec une protection adéquate des sols pendant les travaux. Autour du bâti existant, la végétalisation des abords ainsi que celle des toitures et des façades font partie des actions favorables à la continuité de la biodiversité en ville.
La trame brune : arguments et solutions
La trame brune présente ainsi des avantages concrets pour l'amélioration de la gestion de la ville et du cadre de vie, en plus de la préservation des écosystèmes. Ces opérations ne sont toutefois pas sans conséquences sur la collectivité et peuvent générer des frictions si elles ne sont pas anticipées.
7 raisons d'aménager une trame brune sur sa commune
En résumé, la trame brune améliore :
- la régulation hygrothermique et donc le confort en période de canicule ;
- la gestion des eaux de ruissellement et du risque d'inondation en ville ;
- la qualité de l'air en milieu urbain ;
- la préservation de la biodiversité ;
- la décomposition et la filtration des déchets organiques…
Sous condition, les trames brunes peuvent aussi constituer une ressource locale en matériau et/ou servir de support aux infrastructures de la commune.
Difficultés et bonnes pratiques à mettre en place
En dépit de leurs nombreux avantages, les trames vertes peuvent toutefois soulever des interrogations de la part de la population. Il est important d'anticiper ces questions et d'y répondre par une campagne de sensibilisation appropriée. La création de corridors écologiques peut notamment modifier les circuits de mobilité habituels des riverains.
L'intégration aux trames préexistantes identifiées est un bon moyen de réduire les contraintes induites par la renaturation du terrain. Les services d'un écologue peuvent aider la collectivité dans la conception du projet de la trame brune.